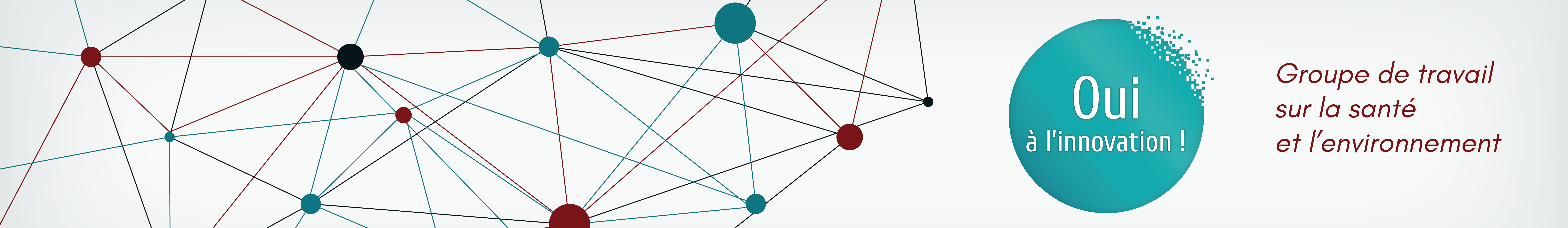Compte-rendu webinaire 27/04/2022
Avec :
- Jean-Paul Bordes, Directeur général de l’ACTA (Instituts Techniques Agricoles)
- Arnaud Rousseau, Président de la FOP (Fédération d’Oléagineux-Protéagineux)
- Yves d’Amécourt, Viticulteur en Gironde
- Josselin Saint-Raymond, Président du collectif « Sauvons les Fruits et Légumes de France ! »
- Jean-Marc Petat, Directeur Agriculture Durable, BASF France division Agro
Pascal Perri, économiste et fondateur de Oui à l’innovation

La question de la souveraineté alimentaire a été l’un des axes de discussion de la campagne présidentielle. Elle le sera encore et pendant longtemps en raison de problématiques franco-françaises et européennes, mais aussi parce que la guerre en Ukraine a encore ravivé cette thématique si délicate. La récolte de blé en Ukraine s’annonce cette année catastrophique. Les observateurs tablent année : -40%. Or c’est le pays est le 2e contributeur mondial au commerce de blé. L’enjeu est majeur : il faut produire dans les pays de l’Union européenne. Et pourtant, ne vit-on pas une injonction contradictoire ? D’un côté, on doit avoir une production agricole solide en Europe, afin d’assurer le fondement même de la pyramide des besoins. De l’autre, les enjeux environnementaux, qui demeurent à raison, justifient des décisions qui sont, elles, discutables. La Commission Européenne a ainsi décidé récemment de la stratégie Farm to Fork qui vise un objectif clair : baisser de 50 % l’utilisation des produits phytosanitaires et de 20 % l’utilisation des engrais. L’impact de ces objectifs a été mesuré par des travaux indépendants de l’université de Kiel en Allemagne et de Wageningen aux Pays-Bas. Ils recoupent ceux du département de l’Agriculture des Etats-Unis (USDA) : tous les observateurs annoncent la décroissance de l’agriculture européenne et française, ce qui entraînerait la mise à mal de notre souveraineté alimentaire. Par ailleurs, la Commission Européenne cherche à imposer un un projet de règlement – appelé Directive SUD – avec effet d’obligation sur les états membres – sur l’utilisation des pesticides. Les objectifs chiffrés sont toujours aussi clairs : -50% d’ici à 2030. Mais ces objectifs sont-ils réalistes ? Les résultats des fermes Dephy, qui rassemblent 3000 exploitations expérimentales en France avec des sites d’essais, accompagnées par l’INRAE et les chambres d’agricultures appuyées par le gouvernement, sont très loin de tels objectifs :
- Grandes cultures / polyculture/élevage : -19 % en moyenne entre l’entrée dans le réseau et la moyenne 2017-2018-2019
- Viticulture : -23% en moyenne entre l’entrée dans le réseau et la moyenne 2017-2018-2019
- Arboriculture : -24 % en moyenne entre l’entrée dans le réseau et la moyenne 2017-2018-2019
- Maraîchage : -30 % en moyenne entre l’entrée dans le réseau et la moyenne 2017-2018-2019
Est-il bien constructif de fixer des objectifs si éloignés de la réalité du terrain ?
Jean-Paul Bordes, Directeur Général de l’ACTA (Instituts techniques agricoles)

Quels sont les axes de recherche aujourd’hui pour réduire l’utilisation des produits phytosanitaires ?
Le contexte est extrêmement complexe parce que nous poursuivons plusieurs objectifs en même temps : la réduction des produits phytosanitaires, mais aussi les solutions face au changement climatique, la préservation de la biodiversité, la neutralité carbone… Par ailleurs, il y a une réduction constante de l’offre de produits phytosanitaires. En 2008, on avait 425 substances actives, aujourd’hui on n’en a plus que 325 : on en a perdu 25 %. Conséquence : nous avons de plus en plus de productions qui sont en difficulté parce qu’elles n’ont plus de solutions conventionnelles pour protéger les cultures. On peut trouver des solutions, parfois même homologuées, mais la question est de savoir si ces solutions sont satisfaisantes. Dans un certain nombre de cas, nous n’avons plus de solution satisfaisante alors même que la pression parasitaire ne fait qu’augmenter : 116 nouvelles espèces d’insectes ont été découvertes entre 2000 et 2014 si l’on en croit la Société Nationale d’Horticulture.
Les instituts de recherche que nous sommes testons les nouvelles solutions qui sont mises au point.
Nous travaillons sur plusieurs axes :
- L’axe agronomique qui permet de limiter le développement des bioagresseurs grâce à l’adaptation des pratiques agronomiques.
- Le biocontrôle, un axe franco-français initié il y a quelques années déjà. Le principe est de rechercher des substances ou solutions qui ne sont pas des biocides, mais qui renforcent et stimulent les défenses des plantes. La garantie d’efficacité n’est pas la même qu’avec des produits conventionnels, mais elle n’est pas anodine non plus. En 2021, il y avait 188 substances de biocontrôle homologuées, qui représentaient 12 % des parts de marché… une proportion en croissance constante.
L’interdiction des produits phytosanitaires est-elle stimulante pour la recherche ?
On n’a pas attendu que certains produits soient interdits pour commencer à faire de la recherche, mais il est certain que les interdictions intensifient le processus. Ce n’est pas parce qu’on interdit ce qui existe et qui est disponible qu’on se donne la garantie de trouver une alternative…
En ce cas, ne serait-il pas sage de n’interdire que lorsqu’on a une alternative vertueuse disponible ?
Oui, ce serait le bon sens, mais on confond les objectifs et les conséquences. On fixe les objectifs sur la réduction en espérant que la conséquence sera la stimulation de l’innovation. En réalité, il vaudrait mieux se donner des objectifs d’innovation pour avoir comme conséquence la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires. La démarche vertueuse serait d’anticiper les nouveaux critères qui empêcheraient telle ou telle substance d’être ré-homologuée. On devrait pouvoir se dire : « Telle substance pose problème ? Il faut avoir trouvé des solutions d’ici 5 ans et que la recherche se focalise dessus. »
Les NBT (New Breedings Techniques) peuvent-elles être un moyen de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires tout en garantissant la production ?
Tout à fait. Nous avons besoin de moyens pour accélérer la création de nouvelles variétés mieux adaptées à ces enjeux de réduction des produits phytosanitaires ou de changement climatique. Les NBT, et particulièrement la technologie d’édition du génome, sont des outils qui nous le permettraient.
Si je devais conclure, je dirais que nous sommes dans une situation très complexe où la clé du succès se trouve dans notre capacité à anticiper. Par ailleurs, il n’y aura pas de changement sans innovation.
Arnaud Rousseau, Président de la FOP (Fédération des Producteurs d’Oléagineux et Protéagineux)

Dans un entretien au Figaro, vous plaidiez récemment pour une troisième voie dans ce débat souvent piégé sur l’utilisation des pesticides. En quoi consiste-t-elle ?
Il me semble qu’il faut remettre un peu de bon sens dans ce débat qui est extrêmement complexe mais trop souvent présenté de manière très manichéenne : d’un côté les « vilains productivistes » qui ne penseraient qu’à l’appât du gain, de l’autre les thuriféraires d’une écologie parfaite qui n’auraient d’autre objectif que l’intérêt général. En réalité, il faut regarder les choses de manière pragmatique. Le monde agricole a deux objectifs, que nul ne songe à contester : il y a une vraie nécessité de continuer à produire pour répondre aux réels enjeux démographiques (l’augmentation de la population en Afrique et sur le sud-est asiatique n’est pas une vue de l’esprit). Par ailleurs, ni les problèmes de géostratégie ni le conflit en Ukraine ne remettent en cause le constat d’un dérèglement climatique et le monde agricole est aux premières loges dans la préoccupation pour les sujets environnementaux.
La question est la suivante : comment répondre à l’enjeu de produire assez, de produire durablement, de produire des aliments de qualité et en même temps, de protéger l’environnement ? Parler de souveraineté alimentaire, ce n’est pas parler d’autarcie. C’est tenter d’établir un savant équilibre entre le choix de nos dépendances, la capacité à produire à des conditions de prix acceptables pour les consommateurs et à des conditions de revenus acceptables pour les producteurs, ainsi qu’une prise en compte des enjeux géopolitiques de notre production agricole : un accident alimentaire majeur aurait des impacts sur le Maghreb, l’Egypte ou la Libye, avec des effets collatéraux évidents. Les réponses à notre question se trouvent dans la manière dont on saura s’appuyer sur la recherche et l’innovation ; sur notre capacité à nous donner une trajectoire et un pack-temps crédibles, favorables à la recherche et susceptibles de donner confiance aux investisseurs.
L’Europe a interdit récemment une molécule, nécessaire à la production du colza. Cette culture est un des éléments de notre indépendance. Pouvez-vous nous expliquer ce dont il s’agit et pourquoi, malgré les impasses techniques, l’Europe persiste dans cette politique d’interdiction ?
En Europe, nous sommes très dépendants du continent américain en matière de protéines. Nous importons notamment du soja, OGM, alors que nous produisons des tourteaux de protéines garantis non-OGM, qui viennent alimenter un certain nombre de segments de marché souhaités par les consommateurs.
Le colza fait partie de ces protéagineux et sa culture est un élément majeur de notre souveraineté alimentaire. Mais c’est également une plante qui nécessite d’être protégée contre les insectes. Nous utilisions pour cela le Phosmet, une matière active qui était la dernière efficace sur un certain nombre d’insectes et qui a été interdite au niveau européen avec un effet actuel. Elle sera complètement interdite d’utilisation au 1er novembre 2022. Il est évident que l’on a besoin de faire évoluer certains produits et le Phosmet, qui n’avait pas un très bon profil toxicologique, est incontestablement de ceux-ci. Le problème est que la décision a été prise de l’interdire avant même d’avoir des solutions de remplacement. Conséquence : on risque une baisse de la production européenne de colza et une hausse des importations avec des produits qui pour la plupart d’entre eux ne respectent ni le cahier des charges, ni les normes. Il y a là une forme de schizophrénie… Certes, je comprends l’argument du citoyen, qui est de dire que le produit n’a pas un profil toxicologique satisfaisant. Mais le problème est que les politiques publiques ne sont pas capables d’investir massivement pour trouver des alternatives.
Comment les pratiques agricoles se sont-elles adaptées à ces objectifs de réduction des pesticides ?
Je voudrais vous donner deux exemples concrets : en colza aujourd’hui, l’Institut Technique Terres Inovia préconise des semis avancés d’une quinzaine de jours depuis ces 5 dernières années, pour avoir des colzas plus robustes, nécessitant moins d’insecticides à l’automne.
Par ailleurs, nous pratiquons la technique des plantes compagnes, des légumineuses que nous semons avec le colza et qui permettent à la fois de capter une partie de l’azote de l’air au bénéfice de la croissance des plants ; et de servir de leurre aux insectes.
Quelle est la place de la science dans cette transition écologique que doit opérer l’agriculture ?
La place de la science est un sujet qui me préoccupe : aujourd’hui, on a globalement en France un niveau en science qui est assez faible, avec une approche de la science assez défiante. Or, pour pouvoir piloter cette transition, pour établir des trajectoires cohérentes et réalistes, pour évaluer ce qui est fait, nous avons besoin de référentiels communs scientifiques. Quand le GIEC nous parle du climat, c’est toujours extrêmement précis : « 1.5 °C, c’est un objectif qu’il faut absolument qu’on respecte ». Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas être aussi précis quand on parle de production ou de critères d’évaluation.
L’agriculture est souvent enfermée dans cette querelle sur les pesticides. A-t-elle pourtant des atouts en matière de préservation de l’environnement ?
Bien sûr, et le contexte nous montre combien les agriculteurs sont attendus sur la question de nourrir la population mondiale. Mais on pourrait également parler de carbone et de la grande capacité de stockage de nos sols. Nous devons reprendre l’offensive et repasser un contrat de confiance avec l’opinion. Nous devons être positifs : d’ailleurs, il est peut-être utile de rappeler que le pesticide, c’est d’abord fait pour tuer la peste. C’est un outil : à nous d’y mettre une vision politique pour emporter une forme d’adhésion.
Yves d’Amécourt, viticulteur en Gironde

Dans vos activités, votre métier, avez-vous une conscience claire de la hiérarchie des objectifs dans les politiques publiques ?
L’objectif n’est pas clairement identifié, parce qu’on mélange tous les sujets : changement climatique, préservation de la biodiversité, réduction des pesticides… Les décisions sont différentes en fonction des objectifs visés, et malheureusement les choix de nos politiques ne sont pas toujours les bons eût égard aux objectifs affichés.
Je prends un exemple : on parle d’un objectif de réduction de 50% des pesticides, mais on ne prend pas en compte que ce qui fait augmenter les tonnages utilisés en viticulture en France, c’est l’augmentation du nombre de conversion biologique des exploitations. La viticulture représente 25% des usages de phytosanitaires en France : plus on va avoir de conversions en viticulture biologique, plus on va utiliser de cuivre et de soufre. Or, le cuivre est le pesticide le plus lourd du marché. En Gironde c’est très clair : si les tonnages augmentent, c’est à cause de la conversion biologique. L’agriculture biologique est une des solutions, mais elle ne peut pas être la seule.
Autre exemple : aujourd’hui, la plus grande concurrente de la souveraineté alimentaire, c’est la souveraineté énergétique. Le nord de l’Allemagne a ainsi consacré 60% de ses surfaces agricoles à produire du maïs qui va être méthanisé, pour produire de la chaleur et du gaz : la souveraineté énergétique vient en concurrence frontale avec la souveraineté alimentaire.
Le contexte actuel, et notamment la guerre en Ukraine, n’est-il pas en train de nous faire sortir de cette logique environnementaliste ?
Ces dernières années, nous avons eu plusieurs électrochocs.
Le premier, c’est la pandémie mondiale qui a changé la vision des populations sur la génétique, l’ADN, l’ARN… autant de mots qui avaient été bannis par les écologistes radicaux. On sait ce que la génétique représente de promesses pour l’agriculture, notamment en termes de réduction de pesticides et de souveraineté alimentaire. La France était en avance sur ces sujets-là et c’est une Française qui a inventé les ciseaux à ADN, qui permettent de faire des greffes directement sur les chromosomes et non sur la plante.
Le deuxième, c’est la guerre en Ukraine qui nous rappelle que nous ne sommes pas souverains énergétiquement, et que le modèle que promeuvent les écologistes (éoliennes, panneaux photovoltaïques, maïs pour faire du méthane…) ne marche pas. Elle nous renvoie aussi à notre politique étrangère : pourquoi la Russie est-elle devenue l’un des premiers producteurs mondiaux de blé ? C’est parce que l’Europe a mis en place des vetos successifs.
En viticulture, avez-vous des impasses techniques liées à ces objectifs de réduction des produits phytosanitaires ?
En viticulture, nous avons un problème majeur : celui des maladies du bois (l’Esca, la maladie du bois noir…) qui font mourir les ceps de vigne. Il y a 20 ans, on traitait à l’arsenic de soude : une solution naturelle mais très toxique qui a été interdite. Des solutions techniques avaient été trouvées, avec des panneaux récupérateurs. Aujourd’hui, il y a des solutions agronomiques qui consistent à changer les mottes de taille, mais elles ont un impact très important de baisse de la production. Aujourd’hui, nous n’avons pas de solutions. Il y a des solutions génétiques, mais dans le cadre des AOC c’est très compliqué de faire rentrer de nouveaux cépages dans les décrets d’appellation. Nous sommes dans une impasse.
Pourquoi aura-t-on toujours besoin de médicaments pour les plantes, et donc de produits phytosanitaires ?
Si on disait aux Français que les médecins vont pouvoir continuer à consulter mais que les médicaments sont désormais interdits, cela ne manquerait pas de poser question. Les produits phytosanitaires sont nos médicaments. Ils ont été inventés au fil du temps par le génie des agriculteurs, des producteurs de molécule, des chercheurs, et la recherche agricole et agronomique en France fait partie des plus beaux instituts de recherche dans le monde, qu’elle soit publique ou privée.
Pour autant, il faut réfléchir sur la manière d’utiliser ces produits. En viticulture, il y a eu une vraie prise de conscience du fait du coût des intrants, parce que les produits phytosanitaires sont chers. Mais aussi à cause du risque que les molécules représentent pour les personnes qui travaillent dans la vigne. Il y a aussi une prise de conscience globale sur l’approche « système » de l’écologie : nous devons mesurer l’impact de nos actions sur le climat, sur la biodiversité, sur la qualité des eaux, et sur l’usage de toutes les ressources naturelles. Cela nous permet de hiérarchiser les problèmes et de ne pas avoir de méthodes concurrentielles.
Quelle place pour la science dans ce débat ?
La recherche est très gênée aujourd’hui par le principe de précaution, que Jacques Chirac a introduit dans la Constitution. A l’époque, il signifiait : « Quand on ne sait pas, on cherche plus. » Aujourd’hui, c’est devenu : « Quand on ne sait pas, on arrête de chercher ». Au nom du principe de précaution, nous avons sabordé un grand nombre de sujets et de compétences sur lesquels nous étions pourtant en avance par rapport au reste du monde.
Car la science a des solutions à nous proposer. Je pense notamment à l’essor de l’agriculture de précision, qui permet, en s’appuyant sur le digital (drones, capteurs…) de cibler les applications de produits phytosanitaires seulement là où les cultures en ont besoin. On arrive ainsi à des réductions de 50, 60 voire 70 % ! Le biocontrôle également : cela fonctionne très bien et les viticulteurs bio ne sont pas les seuls à l’utiliser. Sur notre exploitation par exemple, nous utilisons des argiles pour dissuader les cicadelles de venir abîmer nos vignes.
Nous devons sortir des incantations et redonner envie à la jeune génération de faire de la recherche. Il me semble que si on remet un peu de science et de rationalité dans le débat, alors nous réussirons cette transition agroécologique.
Quelle politique agricole appelez-vous de vos vœux ?
Rappelons quelques chiffres : 60 % des fruits consommés, 40 % des légumes, 50 % de la viande blanche, 25 % de la viande rouge, 75 % des fleurs coupées sont importés. La balance commerciale de l’agriculture française est encore bénéficiaire d’une dizaine de milliards d’euros grâce aux céréales, aux vins et aux spiritueux, mais les économistes ne sont pas très optimistes pour l’avenir. Or le déficit commercial de la balance commerciale de la France est un sujet majeur : entre 80 et 100 milliards selon les années. Nous avons la capacité de faire plus et mieux, à condition que les bonnes décisions soient prises.
Une loi intéressante serait que l’interdiction d’usage s’accompagne d’une interdiction d’importation : il est facile d’interdire quand on sait qu’il y a une solution d’importation derrière ; mais cela met les agriculteurs français dans une situation de concurrence déloyale scandaleuse. Le ministre de l’Agriculture a pris un arrêté en avril 2022 pour interdire l’importation des viandes contenant des antibiotiques de croissance ; et pourtant ces antibiotiques sont interdits d’usage en Europe depuis 2006. Il aura fallu attendre 16 ans alors que la concurrence libre et non faussée est l’une des devises de l’Union Européenne !
Nous avons l’enjeu de la souveraineté alimentaire, mais nous ne mettons pas suffisamment en avant que l’enjeu environnemental profiterait aussi de l’accroissement de notre production. En augmentant la matière organique dans les sols pour en améliorer la qualité, nous contribuons à fixer du CO2 ce qui a un impact majeur sur le climat. Ce n’est pas en entrant dans une politique de décroissance et de dénatalité que nous trouverons des solutions. C’est en remettant l’humain au cœur du dispositif, en refusant les utopies, et en fonçant, avec des objectifs clairs !
Josselin Saint-Raymond, porte-parole du Collectif « Sauvons les fruits et légumes de France »

Est-ce qu’il faut se fixer des objectifs de production ?
C’est une des difficultés aujourd’hui : nous n’avons plus d’objectifs de production. Nous avons des objectifs de protection de la biodiversité, de sortie des pesticides, d’Ecophyto mais nous ne nous soucions plus de la capacité à produire. Nous nous adossons à un principe ésotérique qui est de se dire : « si on supprime les produits phytosanitaires, les équilibres naturels reprendront le dessus et feront le job ! »… comme si la nature était amicale…
En réalité, une production agricole, c’est très complexe. Quand un exploitant traite ses cultures, il ne protège pas un individu, mais une population. Pour cela, on peut utiliser des outils très diversifiés : des moyens très simples, qu’on connaît, qu’on peut utiliser en routine régulière ; mais aussi des outils plus extrêmes dans des situations qui le sont également. On s’appuie alors sur le principe de précaution. Ce principe, c’est justement celui qu’invoquent les écologistes pour sortir des pesticides. Mais on peut le voir différemment : avec la crise de la Covid, au nom du principe de précaution, pour protéger une population, on est allé très vite sur l’homologation des vaccins. On a fait des choix très antagonistes de ceux que l’on fait aujourd’hui en agriculture.
Ne croyez-vous pas que le conflit en Ukraine est susceptible de nous faire sortir de cette logique environnementaliste néfaste pour l’agriculture ?
J’ai bien peur que ce ne soit pas suffisant parce que nos politiques, malheureusement, n’ont pas de plan B.
En matière de fruits et de légumes, 40 % de nos usages (i.e. la recoupe entre un ravageur/maladie et les produits phytosanitaires avec une culture) sont aujourd’hui orphelins : c’est-à-dire que nous n’avons plus de solutions techniques. Je comprends la volonté d’interdire les produits phytosanitaires qui ont un profil toxicologique négatif. Mais le faire sans proposer de solution alternative, c’est laisser le producteur totalement seul, avec parfois même la responsabilité d’avoir des « usages hors-cadre réglementaire ». C’est totalement inacceptable. Notre souveraineté alimentaire dépend de notre capacité à protéger efficacement nos cultures. Sur le point crucial des homologations phytosanitaires, la stratégie européenne et les approches nationales sont totalement en défaut.
Nous devons sortir de la dichotomie bio/non bio : revenons aux faits scientifiques. Nous devons regarder sereinement une troisième voie qui utilise les acquis scientifiques de l’agriculture biologique et conventionnelle, de l’innovation et de la génétique… Cela ne sert à rien de se lamenter : il faut se mettre au travail pour savoir comment faire pour être encore là demain, pour produire efficacement, pour assurer la souveraineté alimentaire de la France, pour susciter des vocations chez les jeunes. C’est à cela que le contexte international doit nous inciter.
Y a-t-il d’autres facteurs qui handicapent aujourd’hui la production française de fruits et légumes ?
Nous sommes en effet confrontés à une décroissance régulière de nos surfaces de production, par perte de compétitivité. Les fruits et légumes ont la spécificité d’avoir un besoin de main-d’œuvre important qui impliquent des différences de compétitivité majeures. Nous tentons de maintenir une production nationale majoritaire, mais l’importation est devenue majoritaire dans la consommation de fruits et légumes en France. Et cette courbe ne cesse de se dégrader, même si elle le fait moins vite qu’auparavant.
Un autre point très compliqué, c’est la judiciarisation croissante de ces sujets d’usage de produits phytosanitaires. Les producteurs sont tenus en permanence dans une sorte de présomption de culpabilité, entretenue par les ONG, qui les met en risque. Encore récemment, des producteurs de pommes ont été contrôlés, mis en garde à vue et condamnés avec des peines extrêmement lourdes en raison d’une loi passée le 24 décembre 2020, et entrée en vigueur le 1er avril. Aujourd’hui, il y a des tribunaux à compétence environnementale qui ont la liberté d’aller consulter des spécialistes : le problème c’est que les juges et les spécialistes sont très souvent des militants.
Pour conclure : nous devons arrêter d’opposer écologie et croissance. Il faut accepter de développer en France un modèle écologique productif, et avoir une ambition d’exportation de l’agroécologie française, y compris au travers des aliments. Pour moi, toute la synthèse est là.
Jean-Marc Petat, Directeur Agriculture Durable BASF France Division Agro

Pour vous industriels, la hiérarchie des objectifs fixés à l’agriculture par nos politiques est-elle claire ?
Le problème est que les objectifs qui sont fixés par nos structures administratives sont des objectifs théoriques, qui ne tiennent pas compte des contraintes des agriculteurs, qui ne tiennent pas compte de la R&D et qui ont donc un impact lourd de conséquences.
Nous avons un exemple très parlant : celui du Danemark, qui est souvent mis en avant par les associations écologistes françaises, mais qui arrive en réalité à une double impasse. Le Danemark s’est engagé dans une démarché ambitieuse de réduction des produits phytosanitaires en surtaxant ces produits pour dissuader les agriculteurs de les utiliser. Malheureusement, cela n’a pas dissuadé les parasites. Pour protéger leurs cultures, les agriculteurs ont dû choisir les produits les moins chers, les génériques, et le nombre de molécules utilisées a ainsi considérablement diminué. Avec deux conséquences : l’apparition de nouvelles résistances et donc des impasses techniques ; et une diminution de la compétitivité et du revenu des agriculteurs. C’est donc un échec et c’est ce qui se passe toujours lorsque les objectifs de moyen ne sont pas mis en regard des objectifs de résultat : les estimations sur la stratégie Farm to Fork concluent toutes à une chute de la production agricole européenne, ce qui est une hérésie par rapport au contexte de crise alimentaire dans laquelle nous entrons.
La recherche propose-t-elle aujourd’hui des solutions innovantes aux agriculteurs ? Y a-t-il des innovations qui existent pour répondre à certaines impasses techniques ?
La recherche se trouve aujourd’hui face à une difficulté : la grande complexité à laquelle le contexte la confronte. Je m’explique : chez BASF, jusqu’en 2018, nous étions des pure players des produits phytosanitaires. Nous consacrions 10% de notre chiffre d’affaires dans la R&D produits phytosanitaires afin de trouver des molécules avec un profil toxicologique et éco-toxicologique toujours plus favorable ; et de travailler à réhomologuer nos matières actives face aux contraintes croissantes. Un tel taux est considérable.
En 2019, sous les pressions notamment de l’Europe, nous avons choisi de devenir un acteur multiple de l’innovation : nous faisons maintenant de la recherche de variétés tolérantes aux maladies, résistantes aux aléas climatiques ; nous sommes dans le digital ; nous accélérons dans le biocontrôle. C’est très bien, mais nous investissons toujours à peu près le même budget mais il nous faut le répartir sur cette multiplicité d’axes de recherche. Cela affaiblit, immanquablement, la recherche. Je crois que nous gagnerions à faire un pacte pour définir nos priorités et orienter tous nos moyens à l’atteinte de ces priorités.
En ce qui concerne les solutions que la recherche peut proposer, nous avons bien sûr des innovations qui apportent des réponses. Je pense à la confusion sexuelle, que nous avons mise au point avec l’INRAE il y a près de 20 ans, qui s’accélère et se développe. Ce qu’il faut préciser malgré tout, c’est qu’il s’agit d’une technologie complexe à utiliser pour les viticulteurs : elle implique de s’associer collectivement entre exploitants, elle nécessite des chantiers collectifs de pose. Elle ne fait pas non plus l’impasse sur l’utilisation d’insecticides lorsque le biocontrôle est insuffisant pour gérer la pression parasitaire.
La deuxième innovation, que nous sommes en train de lancer en France, c’est le pulvérisateur intelligent Smart Sprayer : nous l’avons développé avec Bosch. Le principe de ce pulvérisateur, c’est d’associer le digital et le machinisme pour permettre de détecter les adventices et de pulvériser l’herbicide de manière ultra-ciblée uniquement sur celles-ci. Cela permet des réductions de produits de 50 à 70 %. Le problème, c’est que ce pulvérisateur coûtera près de deux fois plus cher qu’un pulvérisateur classique. Qui va aider les agriculteurs à s’équiper ? L’ambition de réduction des produits phytosanitaires n’est pas un objectif incantatoire : il a besoin de l’innovation. Il a besoin de politiques fortes pour mettre l’innovation à la disposition des exploitants. Et il faut laisser le temps aux agriculteurs de s’adapter.
Comment la R&D peut-elle reprendre la main sur la transition agroécologique ?
Si on veut être optimiste, je crois que le débat est de nouveau ouvert. Nous avons vécu une dérive : les sujets scientifiques n’ont pas été traités comme tels, mais seulement politiquement ou juridiquement. Il faut refaire de la science le pilier de nos décisions.
Nous devons nous mobiliser pour proposer de nouvelles solutions à toutes les agricultures. Par exemple, nous travaillons avec les viticulteurs bio pour les aider à réduire les doses de cuivre utilisées dans la vigne, et qui sont un vrai problème en termes de qualité de l’eau ou de protection des utilisateurs. Nous testons avec eux une solution de biocontrôle, « Romeo », qui est une paroi de levure qui stimule les défenses immunitaires des plantes et permet de limiter les traitements. Cela fonctionne et améliore même la qualité du vin.
Quelque chose m’interpelle, dans ce débat sur les produits phytosanitaires : les associations écologistes, qui nous dictent ce que nous devons faire, sont seulement dans l’incantatoire. Je n’ai jamais vu d’ONG, même celles qui ont les plus gros budgets, investir dans la R&D pour trouver des solutions aux problèmes qu’ils dénoncent. Et pourtant, ce sont eux qui sont consultés pour mettre en place les politiques agricoles. Je crois que pour trouver un plan d’action tenable, il faut mettre autour de la table les acteurs de la R&D, ceux qui sont dans l’action, qui trouvent des solutions : c’est avec eux qu’il faut parler objectifs, science et calendrier d’innovation. Les associations seraient parties prenantes, mais pour vérifier la feuille de route, pas pour parler de science sur laquelle elles ne sont pas compétentes.
Au terme de ces entretiens, « Oui à l’innovation ! » voudrait proposer trois pistes. 1) pas d’annonce de réduction des produits sans compréhension des innovations qui permettront cette réduction ; 2) les objectifs de réduction des produits phytosanitaires doivent être liés à des objectifs de production ; 3) pas d’interdiction sans alternative. Qu’en pensez-vous ?
Je préciserai que la transition agroécologique en France a déjà commencé, mais qu’elle sera forcément plus complexe que le monde d’avant. Il n’y aura pas de grand soir où d’un seul coup, on pourrait se passer des produits phytosanitaires. Le biocontrôle va se développer, la génétique aussi, le digital également… Pour autant, on estime qu’en 2030, les produits phytosanitaires, avec de nouveaux profils toxicologiques toujours plus favorables, représenteront encore 70 % de notre chiffre d’affaires.
Au niveau européen, avec la stratégie Farm to Fork, il ne faut pas se tromper de partenaires et reproduire les erreurs du Danemark ou d’Ecophyto. Les vrais partenaires de Farm to Fork, ceux qui permettront d’atteindre d’ambitieux objectifs en matière d’environnement, ce sont les acteurs de l’innovation et les agriculteurs. C’est pourquoi, nous devons mettre en relation nos ambitions et notre feuille de route « innovation », celle qui permet de dire ce que nous pouvons réellement faire ou pas.